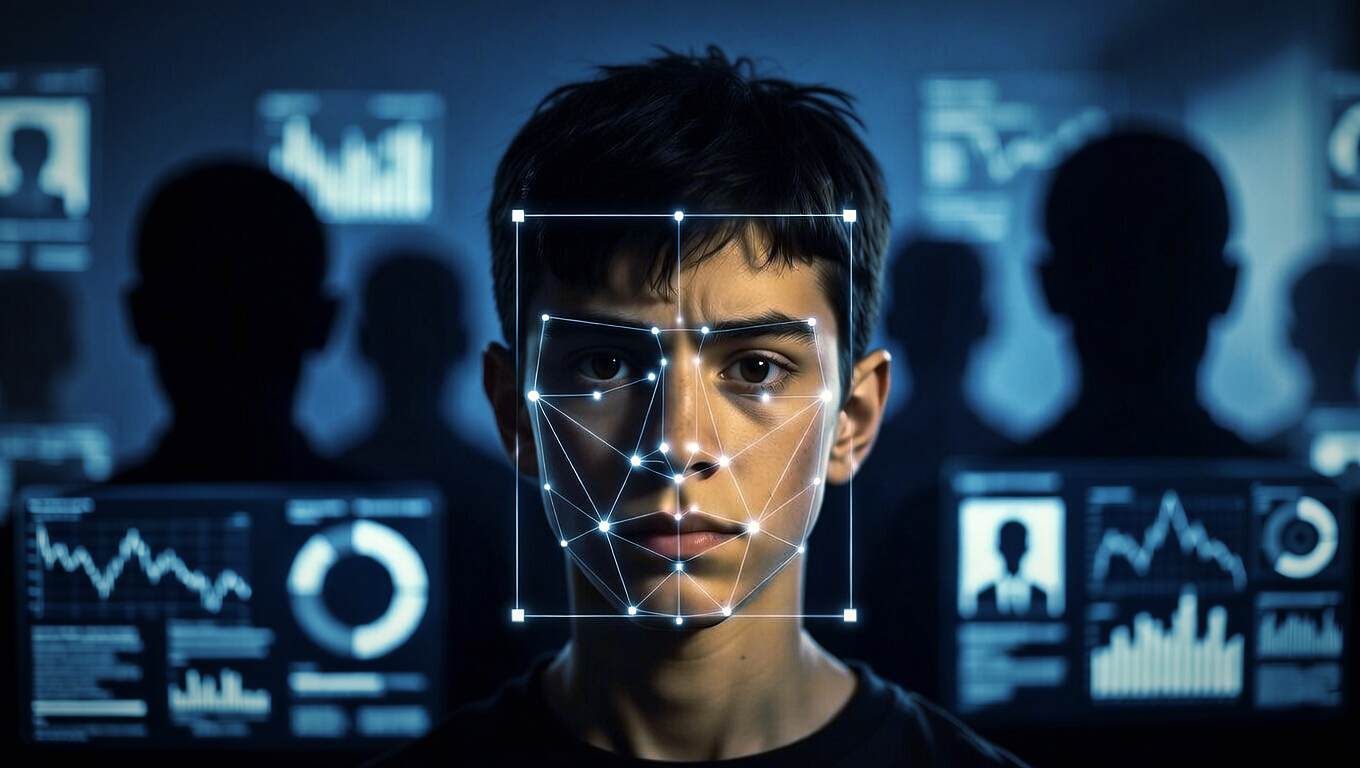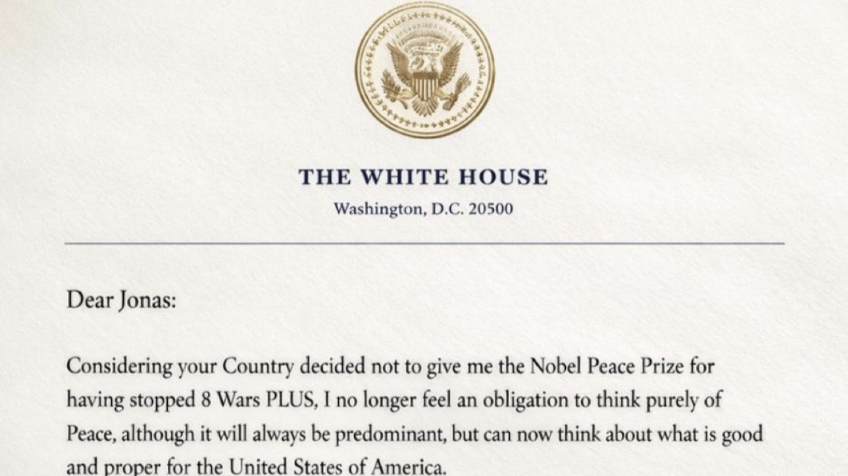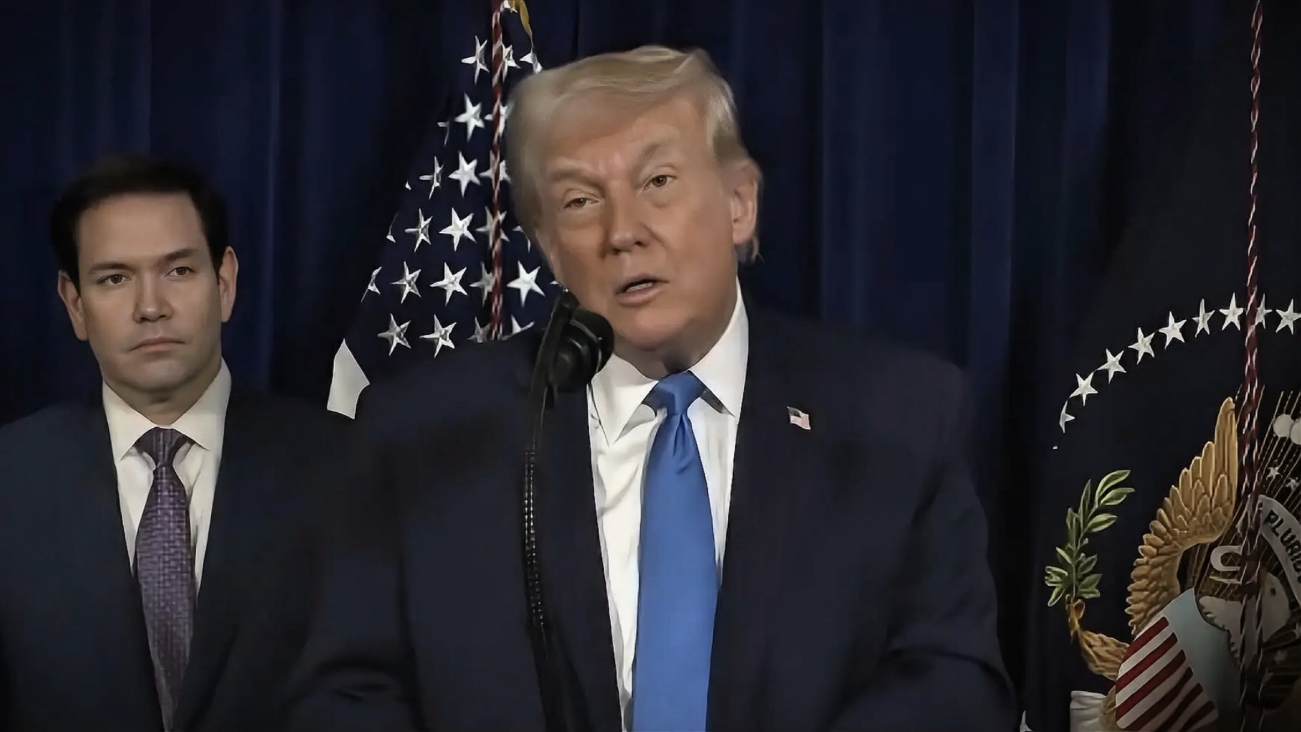Illustration générée par Contre7
Chaque année, l’organisation non gouvernementale Transparency International publie son Indice de Perception de la Corruption (IPC), un classement mondial qui mesure la corruption dans le secteur public de près de 180 pays. Cet indice est devenu une référence internationale, utilisée par les institutions financières, les journalistes et les chercheurs pour évaluer la qualité de la gouvernance. Mais comment fonctionne réellement cet outil ? Sur quoi repose-t-il ? Et quelles sont ses limites ?
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’IPC ne mesure pas la corruption réelle ou prouvée – qui, par définition, est souvent cachée et difficilement quantifiable. Il s’agit d’un indice de perception, qui s’appuie sur les ressentis et évaluations d’acteurs qualifiés concernant le niveau de corruption dans le secteur public : administrations, élites politiques, marchés publics, fiscalité, services de l’État.
Les pays sont notés sur une échelle allant de 0 (corruption perçue comme très élevée) à 100 (corruption perçue comme très faible). Plus un pays s’approche de 100, plus il est considéré comme vertueux. À l’inverse, une note proche de 0 reflète un État perçu comme gangréné par des pratiques corrompues.
Transparency International ne mène pas elle-même les enquêtes. L’ONG se base sur 13 sources produites par des institutions tierces reconnues, telles que :
– La Banque mondiale
– Le Forum économique mondial
– Economist Intelligence Unit
– Bertelsmann Foundation
– Freedom House, etc.
Ces institutions réalisent des enquêtes auprès d’experts locaux et internationaux, de chefs d’entreprise, d’analystes de risques politiques ou économiques. Les répondants évaluent divers aspects de la corruption publique : détournement de fonds, favoritisme, efficacité des dispositifs anticorruption, indépendance de la justice, liberté de la presse, etc.
Pour qu’un pays figure dans le classement, il doit disposer d’au moins trois sources différentes parmi celles retenues. Ensuite, les données sont standardisées pour être comparables, puis agrégées pour donner une note finale sur 100.
Si l’IPC est un indicateur largement reconnu, il n’est pas sans limites :
– Il ne mesure que la perception et non la réalité concrète des actes de corruption.
– Il ignore la corruption dans le secteur privé ou transnational (ex : entreprises occidentales corrompant des régimes étrangers).
– Il ne prend pas en compte les scandales récents s’ils ne modifient pas la perception générale.
– Il favorise structurellement les pays développés à forte capacité institutionnelle, même si des mécanismes opaques y persistent.
En somme, un pays peut maintenir une bonne note tout en pratiquant une corruption « sophistiquée » ou institutionnalisée, peu visible à l’œil nu mais tout aussi néfaste pour l’intérêt général.
La chute du Score Français
La France a enregistré en 2024 sa pire performance depuis plus d’une décennie dans l’Indice de Perception de la Corruption, avec une note de 67 sur 100, en chute libre par rapport aux années précédentes. Ce recul brutal illustre une défiance croissante des citoyens, des experts et des observateurs internationaux à l’égard de l’intégrité de la vie publique française. Depuis la création de l’indice en 1995, la France avait globalement maintenu un score oscillant entre 70 et 75, traduisant une image plutôt stable. Mais depuis 2020, les signaux d’alerte se multiplient et semblent aujourd’hui converger.
L’accumulation de scandales politico-financiers, le sentiment d’impunité dans les hautes sphères de l’État et l’inefficacité perçue des dispositifs anticorruption ont érodé la confiance. L’affaire Sarkozy-Kadhafi, dont le procès s’est ouvert en 2025, a contribué à raviver l’image d’un système politique miné par les conflits d’intérêts et les arrangements illicites. Les condamnations successives de l’ancien président, les révélations dans les dossiers Airbus, Fillon ou Alstom, et la multiplication des enquêtes contre des élus en exercice ou des anciens ministres ont nourri l’idée que la corruption n’est plus l’exception mais une pratique institutionnalisée.
Même lorsque les faits sont jugés, les peines clémentes ou les appels à répétition participent à la désillusion.
À cela s’ajoute une justice perçue comme lente, surchargée, et parfois partiale lorsqu’elle touche aux élites. Le recul de la France dans l’indice est également amplifié par la comparaison internationale : pendant que d’autres pays européens mettent en place des agences puissantes et indépendantes, la France peine à faire respecter ses propres règles. Les plans anticorruption successifs donnent l’impression de rustines sur un barrage fissuré. Le discours politique sur l’éthique est devenu inaudible, tant les pratiques décriées – pantouflages, favoritisme, clientélisme – semblent s’enraciner. Cette perte de crédibilité touche aussi la diplomatie française, notamment dans les forums internationaux où la voix de la France sur la gouvernance ou les droits fondamentaux pèse désormais moins. Derrière les chiffres, c’est une crise profonde de la démocratie représentative qui se profile. Une société où l’idée de justice est perçue comme à deux vitesses ne peut que s’enliser dans le cynisme, la défiance, voire la colère.
La baisse de la note française dans l’Indice de Perception de la Corruption n’est pas seulement une statistique : c’est un symptôme grave d’un modèle institutionnel qui vacille. À moins d’un sursaut, la pente pourrait se poursuivre, et avec elle, l’effritement du lien entre gouvernants et gouvernés.
Suppression de l’ONDRP : quand l’État enterre la transparence sur la criminalité
En décembre 2020, dans une quasi-indifférence médiatique, le gouvernement a discrètement supprimé un organe essentiel à la compréhension de l’insécurité en France : l’Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP). Cet organisme, créé en 2004, ne se contentait pas de comptabiliser les faits signalés par la police ou la gendarmerie. Il allait plus loin : il croisait ces données avec les résultats judiciaires, les enquêtes de victimation, les condamnations effectives et les réponses pénales. C’était donc une rare source statistique indépendante, permettant de mesurer non seulement la criminalité, mais aussi l’efficacité de la chaîne pénale. Et c’est justement ce que le pouvoir politique ne voulait plus voir.
L’ONDRP a officiellement disparu le 31 décembre 2020, en même temps que sa maison mère, l’Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ). Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin justifiait alors cette décision par une volonté de simplification administrative. Mais en réalité, cette suppression a entraîné une recentralisation complète de la production des chiffres de la délinquance au sein même du ministère de l’Intérieur, via le SSMSI (Service statistique ministériel de la sécurité intérieure). Désormais, c’est le ministère chargé de la sécurité qui produit ses propres chiffres… sur la sécurité. On a vu plus impartial.
Les conséquences sont profondes. D’abord, la disparition de l’ONDRP a fragilisé la continuité des séries statistiques. Les comparaisons dans le temps deviennent plus difficiles, notamment sur des sujets sensibles comme les violences sexuelles, les atteintes aux biens ou la récidive. Ensuite, l’indépendance méthodologique est en question. L’ONDRP bénéficiait d’un conseil scientifique pluraliste et d’une autonomie d’analyse. Ce n’est plus le cas aujourd’hui. Enfin, la transparence publique a reculé. L’ONDRP publiait chaque année un rapport complet, accessible, assorti de commentaires critiques. Le SSMSI, lui, se contente de livrer des tableaux chiffrés bruts, sans recul ni mise en contexte.
Cette reprise en main statistique par l’exécutif s’inscrit dans une tendance plus large : celle de la production de chiffres à des fins politiques. Au lieu d’avoir une photographie neutre de la réalité, on fabrique un récit. Celui d’une délinquance en hausse quand il faut justifier plus de répression, ou d’une stabilité quand il faut calmer les esprits. La disparition de l’ONDRP est donc tout sauf anecdotique : elle prive les chercheurs, les journalistes, les ONG et les citoyens d’un outil de contrôle démocratique sur les politiques de sécurité et de justice.
Et ce mouvement s’accompagne d’une autre réalité tout aussi préoccupante : l’absence chronique de données précises et accessibles sur la corruption, le blanchiment, la délinquance financière ou les détournements de fonds publics. La justice française ne publie aucun rapport annuel global sur les condamnations pour ces faits. Aucune base publique ne permet de savoir combien de dossiers de corruption aboutissent, combien de peines sont prononcées, ni même combien sont exécutées. La statistique pénale française est morcelée, illisible, et souvent volontairement incomplète. Contrairement à la Suède, aux Pays-Bas ou à l’Allemagne, la France refuse la transparence sur les crimes en col blanc. Ce n’est pas un hasard.
Car si l’État veut que vous sachiez combien de scooters ont été volés dans votre quartier, il préfère que vous ne sachiez rien des arrangements entre élus et entreprises, des infractions fiscales maquillées, des rétrocommissions ou des marchés truqués. Cette asymétrie dans la diffusion des chiffres nourrit le soupçon, renforce la défiance, et entretient le sentiment que la justice est à deux vitesses.
La suppression de l’ONDRP n’est donc pas une simple réforme administrative. C’est un tournant. Elle marque la fin d’une ambition : celle de produire une connaissance indépendante sur la réalité criminelle du pays. À sa place, l’État nous offre des chiffres sous contrôle, une information calibrée, et un discours sécuritaire où la délinquance des pauvres est scrutée à la loupe, pendant que celle des puissants disparaît dans les marges.
Faux suicides
Juillet 2025, Olivier Marleix, député Les Républicains et ancien président du groupe parlementaire à l’Assemblée nationale, est retrouvé pendu à son domicile. L’élu, réputé pour son travail d’investigation sur l’affaire Alstom et ses liens avec Emmanuel Macron, devait prochainement relancer une série de questions écrites au gouvernement sur les conditions opaques de ce démantèlement industriel. Quelques jours auparavant, il publiait des tribunes dénonçant la captation de la souveraineté économique française par des intérêts étrangers. Le parquet conclut à un suicide, sans qu’aucune note ni antécédent ne vienne étayer cette hypothèse.
Ce drame s’ajoute à une série noire qui frappe des personnalités exposées ou impliquées dans les rouages de l’État profond. En 2024, la Direction générale des Finances publiques connaît une hécatombe silencieuse : treize agents se suicident en six mois, tandis que huit autres tentent de mettre fin à leurs jours. Ces fonctionnaires, souvent affectés au contrôle fiscal, à la lutte contre le blanchiment ou à la surveillance des grandes fortunes, travaillaient dans des conditions qualifiées d’inhumaines par leurs syndicats. Le ministère minimise. La presse évoque un « malaise social ». Mais dans les coulisses, des sources pointent une mise sous pression des agents qui s’attaquent à des circuits financiers trop sensibles, au moment même où les données sur la délinquance financière deviennent plus floues, les enquêtes plus longues, et les peines plus rares.
Trois ans plus tôt, en 2021, l’affaire François Vérove, surnommé « Le Grêlé », fait la une. Ancien gendarme, ancien policier, il est identifié comme étant l’auteur présumé de plusieurs viols et meurtres restés non élucidés depuis les années 80. Quelques jours après avoir été convoqué pour un test ADN, il se suicide dans un appartement de location. S’il était un criminel isolé, comment expliquer son impunité pendant plus de trente ans, alors même qu’il travaillait au cœur des institutions chargées de le retrouver ? L’affaire laisse un goût amer, d’autant que des documents confidentiels retrouvés dans ses affaires ne seront jamais rendus publics.
Remontons en 1995 : le magistrat Bernard Borrel est retrouvé carbonisé dans un ravin à Djibouti. L’État français conclut au suicide, malgré des indices accablants de mise en scène et des incohérences majeures dans les expertises. Borrel enquêtait sur des dossiers brûlants mêlant diplomatie, intérêts pétroliers et trafic d’armes. Depuis, l’affaire a été rouverte plusieurs fois, mais aucune vérité judiciaire n’a été reconnue.
Enfin, en 1979, le corps du ministre Robert Boulin est retrouvé dans une mare forestière.
Officiellement, il s’agit là encore d’un suicide. Pourtant, de multiples fractures au visage, des incohérences dans la scène de crime et des témoins réduits au silence nourrissent depuis quarante ans la thèse d’un assassinat politique maquillé.
Dans chacun de ces cas, la thèse du suicide est rapidement avancée. Et dans chacun de ces cas, les victimes avaient un lien direct avec des affaires sensibles, des réseaux d’influence, ou des fonctions d’observation sur les dérives du pouvoir.